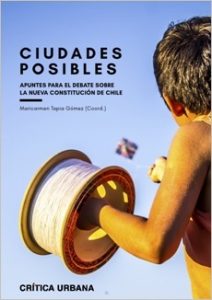Por Nadja Monnet.
CRITICA URBANA n.2
Dans sa conférence sur l’art d’habiter Ivan Illich distingue entre habitant et logé. Cette distinction m’interroge sur la manière de considérer certains habitants et leurs rôles dans la fabrique de nos villes contemporaines. Dans son discours, il postule également une incompatibilité entre le droit au logement et l’art d’habiter que je me propose de revisiter pour ouvrir sur une question : notre siècle sera-t-il celui du droit d’habiter?
Droit au logement versus art d’habiter
En prenant comme point de départ la conférence d’Ivan Illich prononcée, à York, en juillet 1984 à l’occasion du 150ème anniversaire de la fondation de l’Institut royal des architectes britanniques et intitulée «L’art d’habiter«, je propose ici de réfléchir à la question de l’incompatibilité que cet auteur pose entre le droit au logement et l’art d’habiter.
Ma lecture de ce texte, non linéaire et sans prétention de synthèse, est mue par ma pratique d’enseignement de l’anthropologie à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille mais trouve son origine dans mon implication dans la coordination d’un axe de réflexion au sein du laboratoire Architecture/Anthropologie (LAA) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, qui pose la question de l’habitant. Qui est considéré habitant en ce XXIème siècle et quel est le rôle de cette figure dans la fabrique de nos milieux de vie contemporains ? Face, depuis une bonne dizaine d’année, à la prolifération de publications, cycles de conférences et séminaires sur la question de l’habiter, nous avons commencé à recenser cette production et nous nous sommes également intéressés aux textes plus anciens sur le sujet. C’est lors de cette prospection que je suis tombée sur la conférence d’Ivan Illich, traduite et publiée en 2016 par la maison d’édition parisienne Du Linteau. (C’est de cette édition que les citations ci-dessous sont extraites). Traduire et publier un texte prononcé 35 ans auparavant, n’est pas anodin.
La conférence s’est tenue à une époque où les grands ensembles étaient fortement décriés et où les premières démolitions de tours et de barres avaient déjà eu lieu. Elle s’inscrit clairement dans ce moment de dénonciation du logement fabriqué rapidement, en grand nombre, à bas coût et selon un standard, considéré comme l’idéal pour tous. Si nombre de ses affirmations font parties actuellement des lieux communs des opposants à la construction de ce type d’habitat en Occident, sa réflexion sur le droit au logement qui annihile le droit à habiter mérite d’être revisitée, tout comme la distinction qu’il établit entre habitant et logé. En effet, l’injonction à la participation dans la fabrique de la ville, toujours plus pressante, a rendu les termes «habiter», «habitant», incontournables dans le vocabulaire des concepteurs et de ceux et celles qui analysent l’urbain. Ceux de «logé» ou de «résident» sont par contre beaucoup moins présents. La connotation négative donnée au premier est très claire dans le texte d’Illich : le logé semble incapable d’habiter. Il est un analphabète dans l’art d’habiter et est jugé sévèrement.
Dès les premières pages, l’auteur pose de manière antagoniste la situation d’un avant atemporel, connoté positivement, face à la période contemporaine au discours : «Jamais la demeure n’était achevée avant d’être occupée- contrairement au logement contemporain, qui se délabre dès le jour où il est prêt à être occupé» (p.6). Construire peu à peu son logement serait alors le signe d’une capacité d’habiter que l’habitat clé en main ne permet plus. Une certaine nostalgie de l’auto-construction fait son apparition et le droit au logement (responsable de la production en masse d’habitat bon-marché, permise par l’invention du béton et la mécanisation de la construction) serait devenu incompatible avec l’art d’habiter : «Le logé a perdu énormément de son pouvoir d’habiter»» (p.8). «Il apprécie ce droit [celui d’exiger un nombre de mètres carrés dans l’espace construit] et s’en prévaut. L’art de vivre lui est confisqué : il n’a nul besoin de l’art d’habiter – mais seulement d’un appartement» (p.9). Le logé est décrit comme parqué dans un espace où il ne lui est pas permis d’y laisser des traces de son vécu : «Le logé vit dans un monde qui a été fabriqué. Il n’est pas plus libre de se frayer un chemin sur l’autoroute que de percer des trous dans ses murs. Il traverse l’existence sans y inscrire de trace» (p.9). L’art d’habiter revendiqué par Ivan Illich aurait disparu ou du moins aurait de la difficulté à s’imposer face à un droit au logement qui semble annihiler d’emblée l’art d’habiter, l’être humain se retrouvant dans l’incapacité de prendre possession de ces «casiers de résidence» (p.9) ou ce qu’Illich appelle aussi des «garages d’humains» (p.10).

Des logés habitants?
Dans cette distinction entre habitant et logé, il semblerait que le logé ou le résident (termes apparemment synonymes pour Illich) devient un sujet passif qui n’investit plus son lieu de résidence. Contrairement aux habitants qui s’inscrivent et vivent pleinement leurs espaces de vie, les logés sont présentés comme inactifs et incapables de s’opposer aux tendances qui leur sont imposées : «Les habitants occupant l’espace qu’ils modèlent ont été remplacés par des résidents abrités dans des constructions produites à leur intention, dûment enregistrés en tant que consommateurs de logement protégés par une législation sur les contrats de location ou sur les prêts hypothécaires» (p.10). Si l’habitant est producteur d’espace à sa mesure en le modelant, le logé n’est que pur consommateur.
L’idée de résidents de barres ou de petits pavillons collés les uns aux autres, incapables de faire de leur logement un chez soi en accord avec leurs besoins a été depuis fortement nuancée, notamment (mais pas uniquement) avec des travaux de sociologues et anthropologues de l’habitat ainsi que par ceux de cinéastes ou de photographes qui ont su mettre en avant la capacité d’adaptation et la créativité de ces «habitants». Les mouvements de protestation et les actes de résistance face à la démolition de barres condamnées démontrent également l’attachement des habitants à leur lieu de vie. Plutôt que de postuler la disparition de l’habiter, chercheurs et artistes ont montré sa persistance et les «accommodements» des citadins face aux impositions du haut qui agissent avec la volonté de «mieux loger» et de «mieux contrôler» les populations.
«La lutte pour le droit au logement a créé un produit de consommation qui échappe, dans sa phase d’élaboration et de construction, à la grande majorité des futurs habitants car il a peu à peu été pensé et projeté par les architectes, puis actuellement, de plus en plus pris en main par des entreprises de construction qui cherchent la rentabilité».
Si je n’adhère pas au pessimisme d’Illich sur l’incapacité des personnes qu’il qualifie de «logées» à prendre possession des espaces construits sans elles, la relation de cause à effet qu’il établit entre ce type de logement et la production de la rareté d’un bien me semble toujours d’actualité[1] et peut-être encore plus saillant que jamais. Car selon les travaux de la graphiste Manuela Pfrunder[2] ce ne sont pas les m2 par habitants qui font défaut mais la manière de les exploiter qui crée la carence. Ivan Illich insiste sur le fait que le logement est devenu un bien de consommation, donc rare par définition. Ce qu’il appelle l’Homo castrensis serait le propre de la société industrielle «qui s’efforce de faire de chaque citoyen un élément qu’il faut abriter et qui est donc dispensé du devoir de […] l’art d’habiter» (p.10). Plus loin dans son texte, il parle du lien entre construction de la nation et édification : «Bâtir la nation et construire des logements sont des utopies étroitement liées dans la réflexion des élites» (p.18). La lutte pour le droit au logement a créé un produit de consommation qui échappe, dans sa phase d’élaboration et de construction, à la grande majorité des futurs habitants car il a peu à peu été pensé et projeté par les architectes, puis actuellement, de plus en plus pris en main par des entreprises de construction qui cherchent la rentabilité[3] et qui interprètent les lois sur les minimum vitaux des pièces, comme des mesures à respecter pour la taille des pièces, ce qui produit des logement de plus en plus exigus. En parallèle, il est demandé «aux habitants» de participer à la fabrique de leur ville en leur donnant la parole et en créant des débats d’idées pour qu’ils/elles expriment leurs points de vue et donnent leur opinion. Dans ce débat se pose la question de qui sont ces habitants et au nom de qui parlent-ils ? Seront-ils les futurs logés et/ou usagers de la proposition mise en discussion dans l’arène publique ? Quels intérêts défendent-ils ? Les leurs ? Ceux de leurs descendances ? Ceux du milieu ? Le bien commun ? Seront-ils moins logés et plus habitants pour autant ?
Les habitants et l’art d’habiter
«Habitude et habitat disent presque la même chose. […] C’est un art [l’art de vivre] qui ne s’acquiert que progressivement. Chaque être devient un parleur vernaculaire et un constructeur vernaculaire en grandissant, en passant d’une initiation à l’autre par un cheminement qui en fait un habitant masculin ou féminin» (p.7). L’habiter est donc un réseau de liens privilégiés avec un lieu. Illich disait aussi : «Habiter, c’était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage» (p.5-6), un rapport routinier imagé et agi à un lieu, un chez soi quelque part. Combien de temps faut-il pour établir cette routine ? Une vie ? Quelques mois ? Les temporalités ne sont donc pas sans importance: l’enfant n’est certainement pas le même habitant que la personne du 3ème ou 4ème âge. Le temps long de l’histoire mais également les âges et les moments de la vie sont à questionner. Comment alors articuler les dimensions temporelles et spatiales dans l’analyse des figures de l’habitant?
«Le logement moderne aurait donc non seulement transformé l’habitant en logé mais serait également responsable de la destruction de la vie communautaire qui façonne les lieux, l’économie du bien-être ayant quasiment supprimé l’art d’habiter».
«L’art d’habiter est une activité qui dépasse la portée de l’architecte» (p.7) écrit Illich. C’est un art qui ne se limite pas au modelage des intérieurs mais qui concerne également les espaces communs et l’organisation de la communauté. Or, selon lui, «Chez le consommateur d’abri moderne, la distinction entre espace privé et espace public ne remplace pas la distinction traditionnelle entre le logis et les communaux articulée par le seuil – elle la détruit» (p.13).
Le logement moderne aurait donc non seulement transformé l’habitant en logé mais serait également responsable de la destruction de la vie communautaire qui façonne les lieux, l’économie du bien-être ayant quasiment supprimé l’art d’habiter. Ivan Illich dénonce alors que, depuis le milieu des années 1950, «presque partout dans le monde de puissants moyens ont été mis en œuvre pour violer l’art d’habiter des communautés locales et créer de la sorte le sentiment de plus en plus aigu que l’espace vital est rare» (p.14). Pour lui, ce qu’il appelle «le viol des communaux» est aussi brutal que la pollution des eaux, le smog, etc., détruisant «ce qui a déterminé pendant des millénaires le caractère évolutif de l’espace habité» (p.19), à savoir «la culture, l’expérience et la pensée». Les communautés seraient de moins en moins en capacité de négocier entre leurs membres et avec le milieu les règles d’un vivre-ensemble en adéquation avec leur représentation du monde. Est-ce que l’injonction à la participation des habitants dans la fabrique de nos villes contemporaines permet de renouer avec ce qu’Illich nomme le devoir d’activité communautaire, constitutif de sa manière de concevoir l’art d’habiter ?
L’habitant n’est pas un profil abstrait, mais un sujet vivant, singulier. Certaines approches de la ville utilisent une conception réductrice de l’habitant, en taisant les différences et les inégalités. Mais comment tenir compte de cette pluralité de figures mises sous le vocable d’habitant dans les processus de concertation? Qui est actuellement hissé au rang d’ «habitant» et par qui? Quel type d’acteur est-on là où on habite? Qu’est-ce qu’on habite? Actuellement, il semblerait que l’action est constitutive de l’ «habitant». Si une personne agit sur son milieu, elle l’habite. Deviendrait-on alors citadin (à entendre ici comme habitant d’une ville et à distinguer du citoyen qui a des droits et des devoirs envers une nation), parce que nous serions porteur de projet?
Les défis de l’art d’habiter
L’art d’habiter ne semble pas tant passer par la consultation citoyenne mais bien plus par le faire. Pour Ivan Illich, celui-ci ne persiste que dans les marges (aussi bien favorisées que défavorisées) de la population et dans les «Suds».
«Ceux qui, aujourd’hui, revendiquent leur liberté d’habiter par leurs propres moyens sont soit fortunés, soit traités en déviants» (p.10). Ivan Illich appelle également ces derniers des «débranchés», ceux qu’actuellement le sens commun et la presse étiquettent d’alternatif, antisystème, mais également ceux qui sont sortis involontairement du système, comme les sans domicile fixe[4].
«Dans le tiers-monde, c’est la survie même qui dépend du juste équilibre entre un droit à l’auto-construction et le droit de propriété sur une parcelle de terre et sous le toit dont on s’est doté» (p.21).
Pour lui, c’est au nord qu’il faut trouver des solutions pour faire avancer les choses et celles-ci doivent s’inspirer de ce qui se passe au sud. Il conseillait de traiter l’engouement des jeunes envers les modèles du sud avec «courage et réflexion» (p.20). Si je suis persuadée que l’engouement des jeunes qui se posent des questions hors des sentiers battus est à encourager et à soutenir et si je suis convaincue que les Suds et les marges sont force de proposition, c’est à la condition qu’ils se soient débranchés des modèles constructifs imposés dans et par le Nord et que leurs modèles vernaculaires ne soient pas exportés de toute pièce sans questionnement sur les raisons de leur existence et de leur fonctionnement.
Je terminerai ce commentaire, en nuançant l’idée d’Ivan Ilich sur l’art d’habiter comme phénomène proprement humain. Il commençait sa conférence ainsi : «Habiter est le propre de l’espèce humaine. Les animaux sauvages ont des terriers, les chariots rentrent dans des remises et il y a des garages pour les véhicules automobiles. Seuls les [H]ommes[5] peuvent habiter. Habiter est un art.[…] L’humain est le seul animal à être un artiste, et l’art d’habiter fait partie de l’art de vivre. Une demeure n’est ni un terrier ni un garage» (p.5).
Les revendications des antispécismes, c’est-à-dire des personnes qui se refusent à penser l’espèce humaine comme supérieure à toutes les autres et au centre de toute réflexion – ainsi que les nouvelles connaissances en paléontologie, en biologie et en anthropologie physique – ont remis en question les limites qui semblaient auparavant si évidentes entre êtres humaines et autres espèces animales. L’habitant est-il uniquement humain ? Est-ce que tout être vivant est en capacité d’habiter et plus largement d’être artiste, sensible à l’esthétisme? Sans pouvoir répondre à ces questions, je considère important de décentrer notre regard et de poser ces questions par rapport aux autres êtres vivants sans omettre les végétaux dans la réflexion sur l’art d’habiter, à l’image de la thèse en cours de rédaction de Julie Cardi qui, depuis l’architecture, l’urbanisme, les sciences humaines et sociales et l’entomologie réfléchit au moyen de générer une coexistence acceptable entre moustiques tigres et êtres humains.
Après le droit au logement, le défi du XXIème siècle sera-t-il le droit à habiter pour tout être vivant ?
________
[1] Selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, en France, en 2016, il y a 5,8% de la population de mal logés soit 3,8 millions de personnes. Ils représentaient 20% de la population (soit 8,5 millions de personnes) au début des années 1950, c’est-à-dire au démarrage des grands travaux de construction des grands ensembles.
[2] Dans son œuvre « Neotopia, un atlas utopographique de la création achevée » (2000), Manuela Pfrunder se base sur les statistiques mondiales disponibles pour présenter un nouvel ordre mondial imaginaire porté par une vision d’équité radicale. En cherchant à distribuer équitablement richesse et misère sur le globe, elle arrive à la conclusion surprenante que chaque être humain pourrait disposer d’un terrain de 290m2 mais devrait limiter drastiquement la consommation de certaines denrées, en ne buvant, par exemple, qu’un café tous les deux mois.
[3] Actuellement en France la nouvelle loi ELAN permet de construire certains types de logement sans le visa d’un architecte ce qui permet à des promoteurs immobiliers de faire l’économie des conseils et services de ces derniers.
[4] Il s’agit ici des personnes communément désignées en France sous le sigle de SDF qui est le terme qui a remplacé ceux de « vagabonds », « clochards », etc. qui sont désormais considérés comme politiquement incorrects. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas SDF mais qui n’ont pas véritablement de résidence fixe. Je pense ici aux personnes qui naviguent régulièrement entre plusieurs logements, plusieurs villes et parfois plusieurs pays pour des raisons professionnelles. Ces personnes, contrairement aux SDF, sont bien ancrées dans le système car produits directs de celui-ci. Il serait intéressant de s’interroger sur quelle sorte de logés ou d’habitants elles sont.
[5] Dans le texte, « homme » est écrit sans majuscule, omettant ainsi la moitié de la population!
| Para citar este artículo: Nadja Monnet. Du droit au logement à celui d’habiter?. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales núm.2. A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2018. |